par cvuilleumier | 8 Juin 2016 | Histoire, Livres
« L’honneur au service du diable, crime de guerre et cruauté ordinaire », publié aux éditions Slatkine/Société d’Histoire de la Suisse Romande, signé par M. Olivier Meuwly, M. Hervé de Weck, M. Claude Bonard et moi-même, et préfacé par M. Dick Marty.
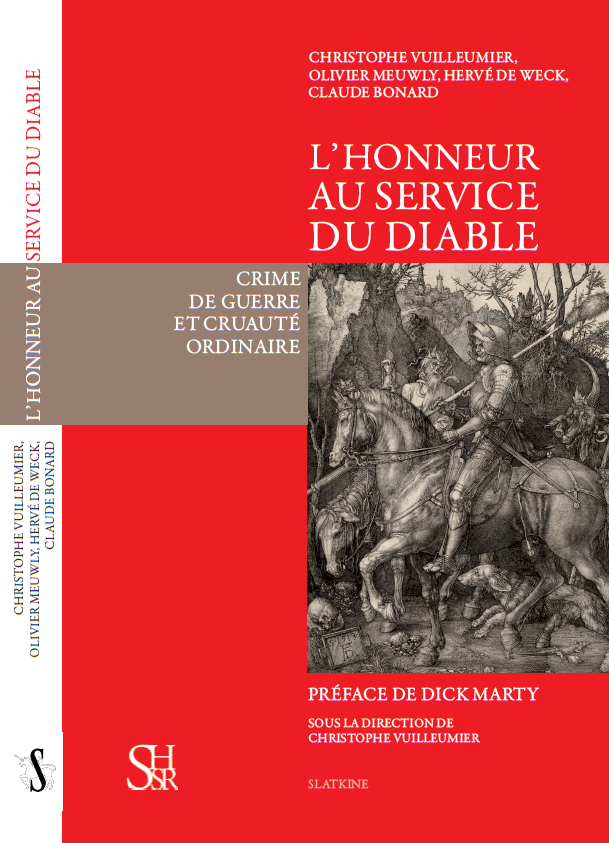

L’Histoire, un rempart contre les crimes de guerre?
FABIO LO VERSO (13 DÉCEMBRE 2016)
La guerre, une affaire ordinaire? Cet ouvrage, sérieux et mordant, fruit de la collaboration entre quatre historiens suisses *, questionne les notions de crime de guerre et contre l’humanité à travers une interrogation tranchante: quelle crédibilité, ou quelle confiance, apporter aux récits de guerre «sans une analyse méthodique permettant de recouper les faits réels»?
L’honneur au service du diable analyse le cas du général nazi Hans Schaefer, combattant sur le front de l’Est en 1943. «Appartenant à une caste imprégnée d’honneur et de fierté», il a été retenu innocent des crimes perpétrés par le régime hitlérien. Le travail d’investigation de Claude Bonard sur les témoignages et les faits de la bataille de Marseille, qui marqua en 1944 la capitulation du général Schaefer, sert de base à l’analyse méthodique de Christophe Vuilleumier — initiateur de ce projet éditorial — Hervé de Weck et Olivier Meuwly.
L’ensemble de cette partition à plusieurs mains oscille entre deux pôles. L’un, plongé dans l’obscurité, laisse transparaître les ficelles de l’impunité des responsables de crimes de guerre, se jouant de la notion d’imprescriptibilité, dont «les charmes illusoires risquent souvent de nous faire succomber», prévient Olivier Meuwly. L’autre, s’offrant à la lumière de la vérité, fait la part belle à l’expertise honnête et rigoureuse, dépassant l’aveuglement idéologique, source de blocages, et exhortant à ne pas confondre, comme le fait Hervé de Weck, histoire et mémoire, «deux approches du passé radicalement différentes».
En parcourant les 165 pages de cet essai paru chez l’éditeur genevois Slatkine, on a l’impression de percevoir l’écho tragique de l’enlisement du conflit syrien et de l’impuissance de la soi-disant «communauté internationale». L’Homme «serait-il donc frappé par une malédiction le condamnant à continuellement s’entre-tuer dans l’abominable tragédie de son histoire?» se demande Christophe Vuilleumier. Mais à travers ces pages, on est surtout saisi par l’ambition de ce collectif d’auteurs de faire de l’Histoire un rempart contre les crimes de guerre. Ce que les lois, «qui viennent à présent dire le bon et le mauvais», ne permettent pas.
Inaction et silence sont peut-être les pires ennemis de la paix. Il reviendrait aux gouvernements d’agir, et aux médias de dire la vérité, à condition qu’elle soit désintéressée. Mais, dans le huis clos mortifère des intérêts des Etats et des rédactions, les non-dits se multiplient, stérilisant les consciences. «La vérité sur les guerres nous aidera peut-être à démystifier certains de ses aspects, que d’aucuns ne manquent pas d’exalter», analyse, dans la préface, Dick Marty, ex-parlementaire fédéral, célèbre pour son enquête sur les prisons secrètes de la CIA. «Elle nous aidera peut-être à considérer et poursuivre les crimes contre la paix, avant même de devoir appréhender les crimes de guerre.» Voilà qui devrait être une affaire ordinaire.
RECENSION PARUE DANS L’ÉDITION DE DÉCEMBRE 2016
* Christophe Vuilleumier, expert de l’histoire helvétique du XVIIe et XXe siècles; Claude Bonard, auteur de divers ouvrages sur l’histoire militaire et sur les relations polono-suisses; Hervé de Weck, ex-rédacteur en chef de la Revue militaire suisse; Olivier Meuwly, responsable de la série Histoire dans la collection du Savoir suisse.
par cvuilleumier | 2 Juin 2016 | Conférences, Histoire

Le 30 mai 2016, la communauté britannique du Pays d’En-Haut commémorait les internés anglais de la Première Guerre mondiale. L’ambassadeur de Grande-Bretagne, David Moran, et le syndic de Château d’Oex, Charles-André Ramseier, assistaient à cette manifestation. Plusieurs conférences ont été proposées par les chercheurs Cédric Cotter de l’université de Genève, Susan Barton de la Montfort University, à Leicester, et par le docteur Christophe Vuilleumier.
par cvuilleumier | 13 Mai 2016 | Articles, Histoire
Journée d’étude organisée par la Société des Arts de Genève
Vendredi 25 novembre 2016
Dans le cadre de son projet de valorisation des ressources historiques initié en 2016, la Société des Arts de Genève propose une journée d’étude autour de la thématique « Penser / Classer les collections des sociétés savantes ».
Cette rencontre invite à s’interroger sur la constitution et les usages des collections des sociétés savantes actives en Europe à partir de la seconde moitié du 18ème siècle et tout au long du 19ème siècle, et à partager des expériences sur la manière dont elles sont conservées et valorisées de nos jours. Elle s’adresse à tous chercheurs confirmés, jeunes chercheurs, archivistes, bibliothécaires, représentants de sociétés savantes souhaitant présenter et débattre d’un thème en lien étroit avec la question plus globale de la gestion du patrimoine des institutions culturelles.
La multiplication inédite d’institutions communément désignées par le terme générique de « sociétés savantes », dédiées à une variété de domaines dont l’émulation économique, l’histoire, les beaux-arts, la philosophie naturelle, l’utilité publique, la géographie, la médecine, l’art militaire, et tant d’autres, est un fait caractéristique des 18ème et 19ème siècles en Europe. Ce phénomène parfois qualifié de « mouvement associatif » est souvent vu comme une manifestation concrète de la diffusion de la pensée des « Lumières » et de l’apparition progressive de l’espace public. Qu’elles aient cessé d’exister ou qu’elles soient encore actives de nos jours, ces institutions disposent pour certaines d’importants fonds d’archives primaires, d’ouvrages et de revues, ainsi que de collections d’objets d’art, d’artéfacts et autres modèles réduits formant des collections plus ou moins riches et complètes selon les cas. Témoins privilégiés du développement du savoir au cours du temps, de l’histoire des institutions, mais aussi des contextes régionaux dans lesquels s’insèrent ces institutions et de leurs liens avec d’autres régions du monde, ces ressources historiques soulèvent d’importants défis pour assurer leur préservation, leur pérennisation et leur valorisation. Comment ces ressources sont-elles mises en valeur, et comment sont-elles intégrées à la recherche historique de nos jours ?
Le comité scientifique encourage les proposants à favoriser les ponts disciplinaires. Les communications peuvent concerner des institutions de la région genevoise ou étrangères.
Exemples de thèmes
– Constitution, enrichissement et dissémination des collections
– Origines locale et globales
– Mise en ordre et classifications des collections
– Rôles, usages et fonctions des collections
– Mise en réseau des collections hier et aujourd’hui
– La collection comme source historique
– Conservatoires, musées et bibliothèques comme dispositifs de conservation et monstration
– Les collections, entre sphère privée et dispositif public
– Inventorier et mettre à disposition les catalogues de collections
Calendrier et modalités de soumission
Les propositions de communication comprenant un bref C.V., un titre et un résumé d’environ 300 mots sont à adresser avant le 15 juillet 2016 à patrimoine@societedesarts.ch.
Les réponses parviendront fin juillet 2016 et un programme provisoire sera disponible à partir de septembre 2016.
Les communications, en français et en anglais, dureront 20 minutes et seront suivies de 10 minutes de discussion.
Participants : chercheurs confirmés, jeunes chercheurs, archivistes, représentants de sociétés savantes
Informations générales
Organisation : Société des Arts de Genève
Lieu : Palais de l’Athénée, 2, rue de l’Athénée, 1205 Genève
Date : Vendredi 25 novembre 2016
Comité d’organisation
Etienne Lachat Secrétaire général de la Société des Arts
Sylvain Wenger Société des Arts
Comité scientifique
Sylvain Wenger Historien-économiste, Université de Genève
Jérôme Baudry Historien des sciences et des techniques, Université de Genève
Vincent Chenal Historien de l’art, Université de Genève
Françoise Dubosson Enseignante bibliothéconomie, Haute école de gestion de Genève
Dominique Zumkeller Historien-économiste et ancien président de la Société des Arts
par cvuilleumier | 18 Fév 2016 | Non classé
Interview dans l’émission de radio Forum le 18 février 2016, sur le centième anniversaire de la bataille de Verdun et les Suisses combattants de 1914-1918. 10 mois d’enfer, du 21 février au 19 décembre 1916, 700’000 tués, blessés et disparus de part et d’autre, une bataille décisive pour laquelle deux autres combats allaient être nécessaires pour faire se replier les armées allemandes impériales. Celui de la Somme du 1er juillet au 18 décembre qui allait faire un million de victimes et celui, moins connu car sur le front de l’Est, de Broussilov, du 4 juin au 10 octobre. Cette dernière bataille allait forcer les Allemands à retirer des troupes de Verdun pour les déplacer sur le front russe, donnant ainsi aux Français un avantage qui allait être décisif.

L’interview: www.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/7487293-cent-ans-apres-la-bataille-de-verdun-ces-suisses-qui-ont-combattu-18-02-2016.html?f=player/popup

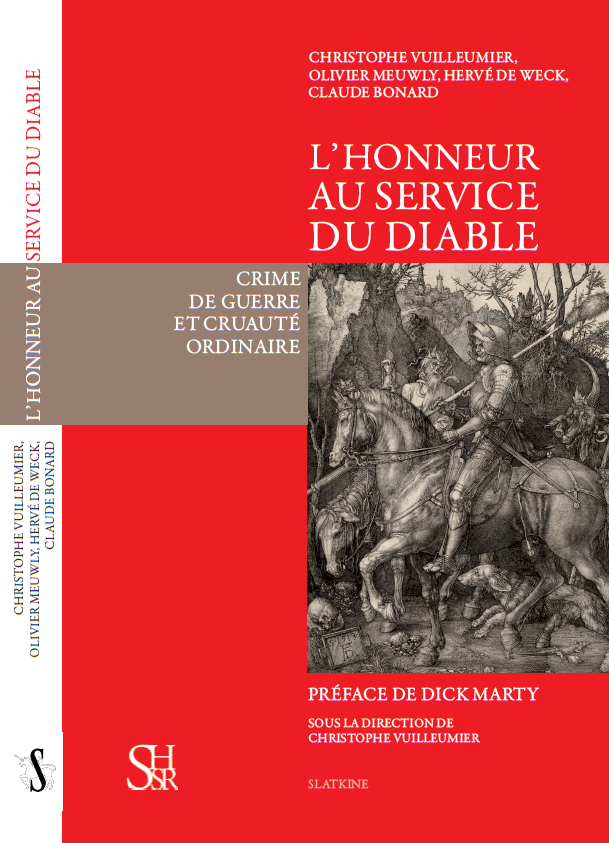




Commentaires récents